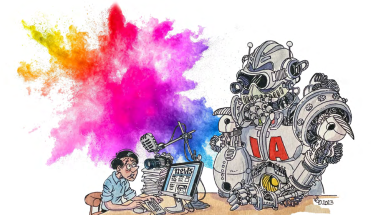Bientôt l’ère post-news ?

Et si finalement, les citoyens, fatigués de réalités parallèles inconnues ou complexes, submergés par les images et les sons, saturés de mauvaises nouvelles, tournaient le dos à une information perçue comme lointaine, partiale, et jugée de moins en moins pertinente ? Au pire moment, en plus : celui où les mouvements extrémistes font l’agenda, celui où les démocraties sont hackées par la désinformation.
Et si après l’ère des fausses nouvelles et de la post-vérité, le redoutable défi des rédactions devenait celui d’une ère post-news ?
Car l’air du temps est bien au repli, à la crainte de l’avenir.
« Bonheur privé, détachement collectif » titrait, cet été, la dernière étude SocioVision, baromètre de la société française depuis 1975. La stratégie de l’autruche fonctionne : le désintérêt des citoyens pour l’actualité internationale et nationale est bien en progression, précise l’Ifop. Et mes collègues des autres télévisions publiques européennes font, tous, cet automne, le même constat.

Back to local !
Face à un monde de plus en plus complexe et incertain, les gens se replient dans leur bulle. C’est le sacre de la vie privée, nouvelle zone prioritaire à défendre et cœur de la vie sociale. Isolés, ils ne se préoccupent plus que d’eux-mêmes et se déplacent moins. Enfermés dans leurs podcasts, ils attendent, chez eux, leur colis Amazon et ils « bingewatchent » les séries Netflix. Même caricaturale, la description sonne vrai.
Il y a peu encore, progrès et modernité allaient dans le sens de l’ouverture, de l’amplification de la diversité. Aujourd’hui, la mondialisation renvoie à une forme rejetée d’uniformisation.
D’où cette tentation du « back to local ».

Si le rêve d’une modernité mondiale s’est envolé, au moins laissez-nous revenir à l’identité, aux frontières, à la protection, etc. Le nouveau clivage politique dominant est devenu « ouverture vs. fermeture », remplaçant « droite vs. gauche ». Le local, voire l’hyper local, l’emporte. La ville, le village, le quartier, l’immeuble, la communauté, la tribu donc, deviennent cruciaux dans un mouvement d’investissement émotionnel naturel vers ce qui est familier, proche, compréhensible, susceptible de partager les mêmes préoccupations. Facebook l’a bien compris en privilégiant, depuis cette année, les nouvelles des amis et de la famille, qui passent désormais devant l’info traditionnelle. Mais aussi en déployant sur son application une section dédiée à l’actu de certaines villes américaines et australiennes.
« Le XIXème siècle était un siècle d’Empires ; le XXème siècle, celui des États-Nations. Le XXIème siècle sera un siècle de villes», avait prévenu en 2009 le maire de Denver, Wellington Webb.
Le reste, on s’en moque !
Dans ce climat, on se protège aussi du chaos du monde, des mauvaises nouvelles, des violences. Surtout si on a l’impression que médias et télévision, créent une réalité parallèle qui n’a rien à voir avec la sienne, voire organisent des débats sans intérêt pour soi.
Ensevelis tous les jours un peu plus, sous un déluge croissant d’images, de sons, de contenus et de données qui déferlent sur tous les écrans, s’accumulant en couches indigestes qui saturent et polluent leur espace mental, nombreux sont ceux qui, dans un phénomène d’auto-protection, expriment désormais leur lassitude à l’égard de l’information. Ils seraient même déjà près de 70% aux Etats-Unis, où on parle désormais de « news fatigue ».

Le flot ininterrompu de mauvaises nouvelles nous ronge, et favorise, selon Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe, la vague populiste mondiale actuelle.
Difficile aujourd’hui de s’en affranchir compte tenu d’une actualité où tragédies, pessimisme et négativité dominent.

Un détachement collectif favorisé par la désynchronisation
Au risque de déchirer encore un peu plus le tissu social ajouré, l’heure est — avec le numérique et la démultiplication des points de contact – justement à la personnalisation des contenus, des loisirs, du divertissement. Mais aussi de l’info. Notamment en raison de la fragmentation des publics et des sources. Chacun, ou presque, a ses propres réglages, son propre flux, ses images, ses vidéos. Son info, et donc sa représentation du monde.
Et avec nos « like », nous sommes chaque jour un peu moins exposés aux informations reçues par les autres. Sauf, s’ils sont dans notre propre bulle de filtre, dans la même chambre d’écho, favorisées par des algorithmes qui privilégient la nouveauté et la popularité de la nouvelle par rapport à son importance ou à sa valeur. La diversité souffre de ces choix mécaniques et tribaux qui favorisent plaisir et habitude dans une vision égoïste axée sur l’immédiateté. Il y a donc danger à voir de larges communautés vivre dans des réalités différentes.

Lassés aussi des réseaux sociaux, le public est aujourd’hui à la recherche de blogs de niche, de newsletters spécialisées, de mini-séries dans des podcasts identitaires, ou même de sites « corporate » dans lesquelles il a confiance (par exemple sur le climat). Loin de la « grande presse », donc. On se moque aujourd’hui des années 1970, durant lesquelles on ne s’informait que sur trois chaînes de télévision et quelques pages de journal. Et on rit déjà de notre addiction à Facebook et Twitter.
Mais aujourd’hui, la Une du journal ou l’éditorial n’ont plus l’impact d’antan et font beaucoup moins réagir. Une des leçons d’Internet, c’est qu’il n’y a plus de monoculture. D’ailleurs, chacun est désormais en relation avec plus de gens qu’il ne l’a jamais été : difficile donc pour un média d’entrer dans le flux de chacun avec le même contenu ou la même info.
Car en dehors des réseaux sociaux, les pages Web existent à peine. Le média social à la mode, Instagram, est un cul-de-sac presque sans lien vers l’extérieur. C’est bien le flux qui a gagné et qui organise l’information. Les gens sont désormais informés via un torrent ininterrompu de notifications, d’alertes, d’infos, d’opinions, d’émotions, distribuées de manière mystérieuse par de complexes logiciels et quelques chaînes en continu. L’info vient à nous. Dans notre poche. A tout moment, et partout. Plus besoin d’aller la chercher le matin dans le journal, le soir au JT.
On se méfie aussi de l’info, et de plus en plus !
Oui, on se défie de façon croissante de rédactions jugées élitistes et déconnectées du terrain, d’éditorialistes vivant dans l’entre soi des puissants et du politiquement correct. De plus en plus, les médias sont classés comme partisans (des présentateurs arrivent même sur scène dans des meetings politiques) et sans grande propension à admettre leurs erreurs.

L’attitude protestataire, antisystème, « dégagiste » a atteint, dans les grands pays, la sphère médiatique, souvent accusée de faire grimper l’audience avec du sensationnel et de proposer une perspective de mondialisation automatique qui ne séduit plus, qui effraie même. Ces mêmes courants protestataires sont bien souvent eux aussi transnationaux, en témoignent les rapprochements entre nationalistes américains, européens, voire russes.
Cette fracture touche les jeunes générations qui, en Europe, ont moins confiance dans l’info traditionnelle que leurs aînées, et ont deux fois plus de chances de s’informer en ligne qu’à la télévision, notamment auprès de leur YouTubeur préféré.
Des rédactions dépassées ?
Oui, souvent dépassées par les nouveaux médias, les bots, les algorithmes invisibles des géants du Web qui maîtrisent et manipulent ces réseaux sociaux où s’informent pour l’instant des milliards de personnes. Dépassée par les trolls, manipulée par des intérêts économiques surpuissants ou par des gens radicalisés qui l’utilisent pour aggraver les fractures dans la société, sans grande culture économique et scientifique, et encore moins numérique, la presse apparaît souvent incapable d’expliquer le monde qui vient.

Des rédactions fautives aussi
Fautives de ratages magistraux et d’un manque coupable d’attention aux signaux faibles. Si le journaliste rapporte ce qu’il juge important à la société et organise souvent le débat, il doit aussi avoir le doigt sur le pouls de cette société et tenter de ne pas rater ses évolutions.
Aux Etats-Unis, la presse, qui a encouragé la guerre en Irak sur la foi de fausses nouvelles non vérifiées, n’a pas été en mesure d’alerter sur la crise financière de 2008 liée au surendettement des ménages et à la folie des banques, et n’a pas cru, ni même vu venir l’adhésion populaire à Trump. Même aveuglement dans les rédactions européennes, surprises par le Brexit ou, il y a quelques années, par le referendum raté en France sur une constitution européenne. D’autres exemples foisonnent : crise climatique sous-estimée, explosion escamotée des inégalités, drame de la tour britannique Greenfell, angles morts sur l’émergence de personnalités (Jeremy Corbin, Macron, Fillon, Hamon, …) avec une autocritique hélas toujours quasi absente.
Et après l’assassinat du journaliste Kashoggi à Istanbul comment ne pas se poser des questions sur 70 ans de couverture du « New York Times » décrivant systématiquement la famille royale saoudienne comme réformiste ?
Des rédactions suivistes en tous cas
Pas facile pour le public d’être en phase avec les moments hystérisés où les médias vont ensemble vers celui qui fait le plus de bruit, notamment parfois au détriment de la science.
Ridicule tendance aussi des journalistes, notamment politiques, à ne se mesurer que les uns par rapport aux autres dans un entre soi, excluant le grand public, et seulement ouvert au microcosme de la classe politique ! Ridicule tendance aussi d’envoyer tout le monde au même endroit pour couvrir la même chose : a-t-on besoin de plusieurs milliers de journalistes pour couvrir une réunion qui débouche sur un communiqué ? Difficile d’y voir de la valeur ajoutée.
Et dans le domaine de la science, que dire de la tendance à mettre au même niveau les phobies de quelques-uns et les avis partagés de la communauté scientifique ? N’est-elle pas à l’origine de la perte de confiance du public dans la science, rabaissée au rang de simple « opinion » ?
Un suivisme aussi hélas désormais favorisé par les algorithmes et les systèmes de recommandations des réseaux sociaux. Un « like » produit un signal et a un effet sur l’info. En quelques heures, une nouvelle bien packagée chasse l’autre, qui, elle, tombe aussitôt dans l’oubli malgré son importance.
Trump l’a compris et a su dompter l’intensité du fameux « news cycle ». Chaque matin, il le kidnappe à sa guise, essentiellement grâce à Twitter, et les rédactions américaines, qui continuent d’établir pour l’instant l’agenda des préoccupations, sont obligées de suivre. Au risque bien réel d’amplifier elles-mêmes la progression d’une propagande extrémiste. Or la lumière ne désinfecte pas ! Au contraire, l’oxygène qui lui est donné ranime le feu. Sans faire acte de censure, n’est-il pas légitime de s’interroger sur la pertinence de donner la parole aux extrémistes sous prétexte d’entendre les points de vue ? Faire des choix est pourtant légitime.

Crise existentielle du journalisme
Jusqu’ici le journalisme a joué un rôle central dans l’élaboration du discours public. Mais la presse n’est plus le mode principal de délivrance de l’information et il est possible qu’à terme le journalisme ne soit plus non plus la manière dominante de rapporter cette information.
A-t-on donc atteint le « peak news » ? A-t-on dépassé, en quelque sorte, l’âge d’or d’une certaine manière de faire de l’info ?
Nous vivons depuis 30 ans, une transformation totale des structures de communication avec la démocratisation (idéaliste ?) de la prise de parole, son transport aisé, l’apparition de nouveaux outils d’amplification qui ont élargi considérablement l’éventail des voix pouvant être entendues. Sans bien réaliser qu’on armait ainsi les extrémistes radicaux, le harcèlement et la haine. Les réseaux sociaux — Facebook, Twitter, YouTube, … – ne sont pas en mesure, on le voit chaque jour, de nous proposer un forum acceptable et représentatif de la démocratie, qui se fonde sur l’idée que l’électeur sait à quoi s’en tenir.
Mais du côté des médias, les indicateurs ne sont pas bons : la presse va mal, les kiosques sont désertés dans les rues et les gares, les JT déclinent, les rédactions sont décimées, l’audiovisuel public est sous pression, partout dans le monde, pour réduire la voilure. Et surtout la défiance vis-à-vis des journalistes et des médias d’information, qui ont perdu le contrôle sur la distribution de leurs nouvelles, s’est installée et grandit. Mais le journaliste, semble avoir renoncé à étudier la transformation de son métier.
Et désormais, la vérité est attaquée. Attaquée par la crise de confiance que traversent les grands pays, la radicalisation toxique et partisane du climat politique, associées au sensationnalisme des médias, aux réseaux sociaux débridés, aux algorithmes programmés pour la viralité. Attaquée aussi par un flot de faits alternatifs, de « junk news », qui mêlés à l’information vérifiée, renforcent la confusion des citoyens, en asphyxiant la démocratie.

Pire ! Le problème n’est même pas que les gens consomment des fausses nouvelles, c’est qu’on ne les atteint plus avec des vraies ! La vérité elle-même est démonétisée, discréditée. On a tellement avalé de couleuvres qu’on ne veut plus croire en rien.
Sans valeur, la vérité est remise en cause sans vergogne dans un scepticisme général mortifère où les faits sont moins importants que les croyances et les convictions. « Le vrai a perdu de sa valeur face au vraisemblable », écrit justement « Libération » cet automne.
Et il ne suffit plus de rapporter l’info, même importante. Le « New York Times » peut publier une vaste enquête sur l’histoire fiscale de Trump, tout le monde s’en moque ! Ou plutôt, cela n’a aucun impact, car ceux dont l’enquête est censée changer l’avis ne la lisent pas !
« Il est peu probable que fournir des informations plus nombreuses et plus fiables arrange les choses (…) La plupart des gens n’aiment pas l’excès de faits et ont horreur de passer pour des idiots », juge l’historien Yuval Noah Harari.
Des faits avérés ne parviennent donc plus à convaincre les électeurs. La priorité est donnée aux émotions et aux opinions. La réalité des faits et la véracité des propos sont secondaires. Le sensationnel l’emporte sur le rationnel, le divertissement sur le fond, et souvent l’image sur le texte. Des menteurs ont pris le pouvoir dans les plus grands pays. Aux Amériques, en Europe, en Asie. Et ils s’attaquent aux journalistes, devenus « ennemis du peuple ».

Le conspirationnisme n’est pas loin : peu importent les accusations. Ceux qui les profèrent se moquent de la réalité, pervertissent les preuves et confondent sciemment corrélation et causalité. En niant la conspiration, les médias alimentent paradoxalement encore davantage la méfiance du public, et l’encouragent à aller enquêter dans des recoins du Web et les bas-fonds de YouTube, qui fait remonter très haut les contenus les plus problématiques, alerte la sociologue américaine Dana Boyd.
Comment restaurer la confiance ?
Qui du gouvernement ou des plateformes va décider de la liberté d’expression ? Et qui des deux profite le plus d’une population non éduquée et sans esprit critique ? Les populistes, qui la rassurent à bon compte, ou les élites amorales de la tech qui s’en moquent ?

Le journalisme pourra-t-il encore éclairer et guider le débat public en confiance ? Continuer à écouter les citoyens, leur donner la parole et l’amplifier, les faire dialoguer, les aider à prendre des décisions informées ? Peut-il faire face à la désinformation, à la chute de la publicité, à l’expansion des technologies numériques ? Peut-il encore empêcher l’inexorable progression vers des régimes populistes autoritaires ? A-t-il une place dans des sociétés où les institutions démocratiques s’effondrent ?
Il existe des pistes auxquelles je crois plus que d’autres. Ce ne sont pas que des « y a qu’à ». Elles demandent des efforts de la part des rédactions, mais aussi des dirigeants (souvent très riches) de médias, et surtout des changements d’habitudes des journalistes. Cela prendra du temps, mais il faut réagir vite car la maison est en train de brûler !
Voici quelques-unes de ces pistes :
- Se différencier, éviter à tous prix le suivisme, chercher à produire ce que les autres ne font pas. Renforcer évidemment l’investigation: « USA Today » vient de tripler son équipe d’enquêtes.
- Arrêter (ou fortement réduire la couverture institutionnelle): faut-il continuer à couvrir n’importe quel déplacement officiel ou la rivière de tweets, donc de mensonges prouvés et de désinformation, d’un président des Etats-Unis, devenu rédacteur en chef ?
« Le président a réussi à faire des journalistes les principaux acteurs de son émission de télé-réalité sans fin, pour le plus grand plaisir de ceux qui l’acclament lors des rassemblements », déplore le « New York Times ».
Surtout quand on sait que l’attention du public se limite aux titres ou à quelques secondes sur une alerte mobile ! Il faut aussi éviter le plus possible les sources anonymes, le fameux « off » qui alimente la suspicion de l’entre-soi, et la relecture des interviews !
- Privilégier et maximiser la confiance dans son info, donc dans son exactitude par rapport à la vitesse, à la course à l’audience, au sensationnalisme, ou même au scoop. Amplifier l’important sans viser les clics. Prendre son temps alors que nous vivons dans une culture de l’instant. Le « slow news », assortie de pédagogie et de contexte, a beaucoup de valeur car l’information qui a un impact est presque toujours celle qui a mis du temps à émerger et à être traitée. Le podcast favorise notamment ce temps long et l’absence de coupures publicitaires permet de penser plus lentement. Bien sûr soigner autant que possible l’impartialité et s’obliger à rendre des comptes. Cela peut aussi se faire à l’aide d’outils numériques et de l’intelligence artificielle. La technologie de blockchain peut aussi aider à distribuer de l’authenticité.
-
- Jouer bien davantage la transparence, pour montrer les coulisses, la préparation, expliquer les méthodes de travail, les mécanismes de la fabrication de l’info, notamment la conférence de rédaction : les citoyens ne savent pas comment se concocte l’info, comment les décisions de couverture se prennent, et comment les impasses sont choisies.
- Et donc inclure l’audience dans le processus, dans la fabrique. Mieux écouter et échanger avec le public, partager sa culture, lui donner la parole, sinon les faits ne suffiront pas: on ne regagnera sa confiance qu’en refaisant partie intégrante du tissu même de la société et des communautés, avec un engagement réel et profond, et non en restant en surplomb dans de vastes studios cathédrales. Il faut donc faire participer la communauté à la mission d’informer. C’est à tout le monde de protéger l’info pour sauver le débat public. Pour cela aussi mieux encadrer et guider les sections de commentaires pour qu’elles ne soient pas seulement des défouloirs, des endroits pour crier, mais un lieu d’annotation utile, d’engagement pour ceux qui en savent plus. Les gens sont prêts à offrir leur expertise aux journalistes dans un processus de collaboration et non d’extraction.
- Donner bien davantage la parole aux jeunes. Sur le climat par exemple, tous les faits scientifiques sont connus, mais on a besoin d’une bonne histoire, d’une narration convaincante que les journalistes ne sont pas parvenus à imposer. Les seuls qui peuvent les faire sortir de leur zone de confort sont les jeunes. Des jeunes qui sont d’ailleurs mieux armés, semble-t-il, que leurs aînés pour faire la différence entre des faits et des opinions dans le nouvel écosystème de l’info, même s’ils privilégient Facebook, voire même Snapchat pour s’informer.
- Reconnaître qu’on est peut-être manipulé par les intérêts économiques qui possèdent les médias, mais aussi par les maîtres de la viralité qui nous piègent et imposent leur agenda, ou par les extrémistes qui proposent un cadre nouveau auquel les gens n’avaient pas encore pensé avec des liens inédits. Apprendre mieux à résister aux opérations de plus en plus sophistiquées et dynamiques de propagande et de désinformation, et éviter de leur donner de l’oxygène. Souvent les rédactions pensent qu’exposer les idées les plus extrêmes disqualifie ces mêmes idées. C’est loin d’être sûr : la manière dont les gens consomment et traitent l’information est probablement plus compliquée.
- Reconnaître aussi que les sujets peuvent être justement plus complexes – et le sont le plus souvent – qu’une opposition simpliste et binaire qui met en scène un débat pour/contre sans nuance. D’autant que tous les sujets n’ont pas nécessairement deux faces. Quand on sépare des enfants de leurs parents et qu’on les enferme, par exemple. Faire appel aux scientifiques, figures de confiance, et arrêter d’interroger toujours les mêmes faux experts qui ne partagent que leur opinion.

- Assumer un journalisme d’impact. Reconnaître que dans ce monde complexe, nous avons un rôle politique à jouer. Le « Washington Post » l’a fait et a modifié sa devise : « La démocratie meurt dans les ténèbres ». Fournir donc aussi des informations actionnables. Un journalisme qui s’intéresse non plus seulement au « why » des fameux 5 W, mais aussi au « so what» and « now what ». Attention aussi à ce qu’on choisit d’amplifier !
- Renforcer l’info locale. Les rédactions n’ont souvent pas perçu le besoin de cette info plus bienveillante, moins anxiogène, plus proche. Si le public nous tourne le dos c’est qu’il juge que nous ne donnons plus une représentation exacte du monde. Il s’agit aussi de mieux faire remonter les lieux et les élans de résistance et d’enthousiasme pourtant bien présents, notamment dans la jeunesse, mais trop souvent à l’insu du plus grand nombre. Des communautés entières sont désormais de véritables déserts où plus aucun média traditionnel n’est présent. Des opérations collectives peuvent là aussi fonctionner.
- Accroître considérablement l’éducation aux médias, notamment pour les plus jeunes et expliquer les logiques qui gouvernent les réseaux sociaux, pour contribuer à renforcer l’esprit critique des citoyens. Oui, Twitter, Facebook ou YouTube sont aujourd’hui des instruments de radicalisation. Et oui, les plus démunis consomment moins d’infos et cette tendance est plus marquée encore en ligne où ils vont moins chercher eux-mêmes les nouvelles. Il est crucial de vivre dans une réalité partagée.
- Aider à cultiver le journalisme ailleurs que dans les rédactions, donner des outils à des leaders dans des communautés, chercher absolument des alliés, qui ne sont pas que des journalistes mais aussi des éducateurs, des experts, des scientifiques.
- Coopérer beaucoup plus avec les autres rédactions et ne pas jouer seulement défensivement pour aller au fond des choses en se partageant le travail, qui ne manque pas, pour expliquer le monde et éclairer là où d’autres ne veulent pas de lumière. Il s’agit bien ici autant d’un partage du travail que de l’association des puissances d’enquête avec aussi l’audience.
- Explorer davantage de nouveaux formats narratifs plus en prise avec la société actuelle : bande dessinée, spectacle vivant, stand-up, cinéma, etc. La série norvégienne « Skam » a mieux informé les ados sur le cyber-harcèlement que n’importe quel média. Les humoristes John Oliver sur HBO ou Hasan Minhaj sur Netflix nous aident souvent mieux à comprendre le monde que n’importe quel journal, même sur les sujets les plus complexes. Probablement parce que nous nous reconnaissons aussi en eux. Le nouveau journaliste est donc un scénariste de l’information, un designer narratif de la réalité du monde, un producteur d’impact, un chef de projets.

- Capitaliser sur le journaliste-individu en tant que marque sur le modèle de « YouTubeurs » spécialisés, qui petit à petit sont parvenus à fédérer une audience, financer des équipements plus professionnels et même des « reportages » sur le terrain. Le modèle d’avenir de la rédaction sera peut-être une coopérative de journalistes indépendants, mettant en commun leurs ressources et leur crédibilité, faisant ponctuellement de la crosspromotion ou des reportages à plusieurs tout en conservant chacun leur communauté et spécialité.
- Evidemment utiliser et soutenir financièrement davantage la production et la distribution de formats longs, de documentaires, d’enquêtes.
L’appétit morbide pour le dramatique, qui passait souvent par l’actualité où les faits divers servaient d’anxiolytiques, se reporte d’ailleurs sur la fiction délivrée par les séries, nous explique Hossein Derakhshan, chercheur en journalisme au Harvard Shorenstein Center et au MIT MediaLab, qui se demande ce qu’il va rester comme rôle au journaliste, coincé désormais entre divertissement et propagande.
- Recruter de manière bien plus diverse que l’actuel cursus classique SciencesPo + école de journalisme. Les salles de rédaction sont bien trop homogènes et reflètent mal leur audience Y sont donc insuffisamment représentées les personnes de couleur, les zones rurales, les banlieues, les étrangers, les jeunes. Le partage des témoignages et du temps de parole hommes (en général experts) / femmes (souvent victimes) doit se faire par les données, pas au feeling. Veiller à l’expertise technologique et numérique pour ne pas être à la traîne de la société, mais aussi économique. Embaucher des experts, notamment scientifiques.
- Trouver les moyens de financer un journalisme qui travaille dans l’intérêt du public et pour le bien commun, et non pour gonfler ses audiences. Mieux payer donc les journalistes qui en moyenne, à diplôme équivalent, gagnent bien moins que leurs anciens condisciples d’universités. Après tout, les médias privés sont la plupart du temps la propriété de milliardaires dont la richesse croît plus vite qu’ailleurs, non ?

- Enfin, osons le dire : montons le niveau de jeu ! « Je crois aussi que le manque d’information de qualité (« de “real news”, de “good news” ou de “trustful news”», ndlr) pose plus problème que la présence de fake news… », estime cet automne le militant Internet Eli Pariser. Il faut accroître la qualité, l’explication, et faire des choix assumés.
Et la technologie ? L’intelligence artificielle (IA) peut-elle résoudre le problème des fausses nouvelles ? C’est la conviction de Mark Zuckerberg et de nombreux experts en intelligence artificielle. Un peu comme on a pu réduire considérablement le spam de nos boîtes email. Mais rares sont ceux qui prévoient ceci à court terme. Il faudrait pour cela que l’IA puisse comprendre les liens pertinents entre les idées et soit accompagnée d’une charte éthique. Il faudra aussi contraindre d’ici là les plateformes à faire vraiment le ménage puisqu’elles ne s’y résolvent pas d’elles-mêmes.
L’IA peut à court terme aider les journalistes eux-aussi confrontés à de larges volumes d’informations à détecter des tendances, des déviances ou des manipulations de masse. A condition de ne pas être eux-mêmes manœuvrés faute de connaissances techniques.
Ce sont les gens qui sauveront le journalisme !
Ce qui va sauver le journalisme, comme l’a dit cet automne la journaliste américaine Heather Bryant, ce ne sera pas l’accent mis sur la vidéo, les médias sociaux, l’organisation d’événements, les podcasts, les newsletters, l’IA ou la blockchain (…) mais les gens.
« L’avenir du journalisme est et sera toujours l’homme, précise-t-elle si justement. Ce qui sauvera le journalisme, ce sont les gens. Ceux qui sont dans nos salles de rédaction et ceux qui sont à l’extérieur. Des gens de tous horizons et de toutes sensibilités. Les gens qui cherchent à utiliser leur voix pour donner du pouvoir aux autres. Des gens qui travaillent ensemble. Notre avenir dépend de la façon dont nous les traitons, dont nous les intégrons ou les excluons, dont nous les représentons et les servons et dont nous investissons en eux. »
Certains vieux médias tirent déjà des conclusions de cette situation préoccupantes et essaient de revenir aux sources en privilégiant le contact direct avec le public pour mieux saisir les attentes, mieux comprendre leurs frustrations, tenter de combler le fossé entre vieux « émetteurs officiels d’infos » et ceux qui les reçoivent ou ne veulent plus les recevoir. La télé publique suédoise a ainsi lancé un « Coffee with SVT ».
On sauve bien les banques, pourquoi pas le journalisme dans des démocraties et un Etat de droit désormais sous pression ? Mais on ne pourra pas longtemps continuer comme avant. Il est peut-être encore temps, si l’existence n’est que rapport de forces, de se rappeler que nous, journalistes, avons encore un peu de pouvoir. Celui d’aider nos concitoyens à vivre dans une même réalité partagée. A condition que nous partagions aussi une même culture.
Car les faits ne tiennent pas tous seuls, rappelle Bruno Latour dans son dernier essai « Où atterrir ? »: « Sans monde partagé, sans institution, sans vie publique, (il ne suffira pas) de ramener tout ce bon peuple dans une bonne salle de classe à l’ancienne, avec tableau noir et devoirs sur table pour que triomphe la raison (…) La question n’est pas de savoir comment réparer les défauts de la pensée, mais comment partager la même culture, faire face aux mêmes enjeux, devant un paysage que l’on peut explorer de concert».
Aider à tenter de refaire société est un nouveau et grave défi pour les rédactions et nos nouvelles tribus éclatées. L’information est un bien commun. Y accéder, un droit de l’homme. Mais des communautés solidaires ne peuvent fonctionner que si nous nous sentons aussi connectés à ceux qui ne pensent pas comme nous.
Eric Scherer
————-
PS : nous développerons ces sujets dans notre Cahier de Tendances Méta-Media N°16, Automne – Hiver 2018/2019 , avec de nombreux témoignages et analyses d’experts et comme toujours notre sélection des meilleurs livres qui en parlent.
Le cahier sera disponible ici, sur Méta-Media en PDF gratuitement début décembre.
(Illustration de couverture : Jean-Christophe Defline)