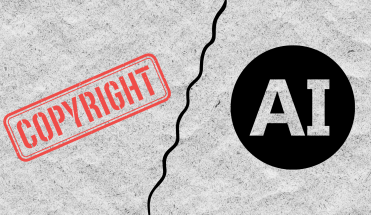Festival International du Journalisme de Pérouse 2025 : How to ‘Make Journalism Great Again’ ?

Face à la double menace des dictatures dystopiques et des intelligences artificielles incontrôlables, le journalisme vacille. Le soleil indulgent de l’Ombrie adoucit les tensions et rend les conversations plus perméables, mais chacun s’interroge sur la survie d’un métier malmené qui doit plus que jamais affirmer sa mission.
Par Kati Bremme, rédactrice en chef Méta-Media, Alexandra Klinnik et Océane Ansah, MediaLab de l’Information de France Télévisions
Ceux qui maîtrisent en profondeur les technologies d’intelligence artificielle et les logiques économiques qui les sous-tendent restent les plus sceptiques face à leur intégration dans les rédactions. Étonnamment, peu de journalistes enquêtent sur l’ampleur du déséquilibre des pouvoirs à l’œuvre dans cette nouvelle révolution sociétale — qui remet pourtant en question la raison d’être même de leur activité. Les analyses percutantes de Karen Hao, Martin Andree ou Christopher Wylie font figure d’exception.
Les early adopters des grands modèles de langage dans les rédactions, de leur côté, ont payé le prix fort : des phases de test et de fine-tuning épuisantes, qui les empêchent d’assurer leur travail de base et de remplir leur mission. Une mission qu’il faut d’ailleurs redéfinir. Les journalistes doivent réapprendre à écouter — certains évoquent même un rôle de thérapeute, s’ils veulent maintenir un lien avec les user needs (souvent portés par les équipes produit), voire avec de simples besoins humains. Des besoins que les créateurs de contenus ont bien compris. Mais eux aussi montrent des signes d’usure, et en viennent presque à appeler l’émergence de nouveaux intermédiaires entre eux et les algorithmes des plateformes dont ils dépendent — avant, peut-être, d’être un jour remplacés par des avatars IA, générés et entraînés sur leurs propres contenus.
Dans certains conflits de ce nouveau monde en guerre, le public semble faire preuve de davantage de news literacy que les grandes rédactions elles-mêmes. Une question s’impose alors, à la fois dérangeante et peut-être un peu datée, héritée de l’époque des gatekeepers : à quoi bon produire un journalisme rigoureux, si celui-ci peut, en toute légalité, conduire à l’élection de dirigeants résolument autoritaires ? Sans prétendre façonner l’opinion, il est peut-être temps de sortir d’une posture exclusivement réactive pour adopter une approche plus constructive, plus accompagnante : offrir des repères, donner des clés de lecture dans un monde toujours plus chaotique, face à des plateformes qui monopolisent désormais non seulement le divertissement, mais aussi l’information.
Si les médias sont aujourd’hui remis en cause (#NewsFatigue), il est peut-être temps d’arrêter de pointer un public prétendument désengagé — et de reconnaître que la difficulté à se réinventer vient d’abord des médias eux-mêmes. Ce dont nous avons besoin : des journalistes un peu plus “full stack”, capables de comprendre leur produit (le monde), de connaître leur audience en profondeur, et de savoir comment l’écouter et lui parler.
A voir
Toutes les sessions sont accessibles gratuitement sur le site de l’IJF 2025, mais voici notre top 3 à rattraper :
- News or noise? The competing visions for journalism in an AI-mediated society
- How to save journalism from big tech
- Captured: how Silicon Valley’s AI emperors are reshaping reality
10 points à emporter :
- Selon David Caswell, personne ne gagne de l’argent avec l’IA générative.
- Dans le nouveau monde artificiel, « Digital doubt is becoming the new normal ». 59,9 % des personnes remettent davantage en question l’authenticité des contenus en ligne qu’auparavant, selon le dernier Wayfinder d’Ezra Eeman sur les tendances des médias.
- D’après Karen Hao, les médias s’associent à OpenAI dans l’espoir de partenariats fructueux, mais la journaliste-ingénieure anticipe un scénario identique à celui des réseaux sociaux, où les rédactions ont été évincées du jour au lendemain.
- Des LLM sont des Large Language Models et non pas des Large Fact Models (c’est toujours bien de le rappeler). Des technologies qui reposent entièrement sur la probabilité sont peut-être en contradiction avec la vérification des faits propres au journalisme.
- Le public cherche de plus en plus des réponses plutôt que des informations. Chaque interface se transforme en machine à réponse. Selon la CJR, près d’un quart des Américains utilisent désormais l’IA à la place des moteurs de recherche classiques.
- Pour Ellen Heinrichs, fondatrice et directrice du Bonn Institute, les rédactions devraient, au lieu de courir après le dernier gadget IA, investir dans plus de journalisme humain. Une conclusion partagée par l’étude « News for all » menée par Cymru et la BBC, Karen Hao ou encore Christopher Wylie, le lanceur d’alerte derrière Cambridge Analytica.
- Peu importe que le journalisme soit financé par des fonds privés ou publics – nous perdrons le journalisme, car c’est la visibilité qui disparaît. L’invention de l’imprimerie a seulement transformé la distribution. L’IA, elle, bouleverse à la fois la production et la diffusion. Martin Andree nous laisse quatre ans avant que les Big Techs ne prennent totalement possession des médias.
- Et si, comme le suggère Chris Moran du Guardian, il ne s’agissait pas de produire davantage, mais autrement ? Plutôt que d’exploiter l’IA pour multiplier les contenus, pourquoi ne pas l’utiliser pour réduire le volume et améliorer la pertinence ? Vers une forme assumée de sobriété éditoriale…
- Les early adopters des grands modèles de langage dans les rédactions ont payé le prix fort : des phases de test et de fine-tuning épuisantes, qui les empêchent d’assurer leur travail de base et remplir leur mission.
- Selon Isobel Cockerell, le Vatican, la « Silicon Valley de l’époque » fait partie des rares institutions à prendre au sérieux les dangers liés à l’intelligence artificielle, « un substitut à Dieu ». « L’ancienne religion semble ainsi mener une bataille contre la nouvelle », ironise-t-elle.
Et voici nos notes en détail :
Comment ne pas se noyer dans l’IA ?
Tout le monde parle d’outils de productivité, mais rares sont ceux qui interrogent la source même de cette exigence de performance : des réseaux sociaux et des appareils connectés en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, affamés de contenu neuf. Et si, comme le suggère Chris Moran du Guardian, il ne s’agissait pas de produire davantage, mais autrement ? Moins de journalisme, mais davantage de service. Plutôt que d’exploiter l’IA pour multiplier les contenus, pourquoi ne pas l’utiliser pour réduire le volume et améliorer la pertinence ? Vers une forme assumée de sobriété éditoriale. Et si les chatbots d’il y a quinze ans, fondés sur de simples arbres de décision, étaient en réalité mieux adaptés au journalisme que les modèles de fondation hallucinatoires des LLM ?
- Dans sa séance d’ouverture, Nic Newman déclare : « Avec l’IA, on ne connaît pas le produit. Il faut expérimenter ensemble et trouver la valeur, en s’appuyant sur notre mission. » Et c’est bien là tout le paradoxe : alors que les rédactions manquent de temps, elles devraient en consacrer plus que jamais à tester, chercher, tâtonner.
- Quand « les journalistes pensent que le langage leur appartient » (Lucy Kueng), l’irruption des grands modèles de langage remet forcément leur rôle en question. Qui produit du sens ? Qui édite quoi ? À partir de quelles intentions ?
- Dans ce nouveau monde artificiel, « Digital doubt is becoming the new normal »

- Ezra Eeman, Directeur Stratégie et Innovation de la NPO, pose la question : faut-il simplement optimiser le processus, ou bien le repenser entièrement en boucles, où l’audience n’est plus en bout de chaîne, mais au cœur du système ? Le public ne cherche plus seulement des informations, il attend des réponses. Et chaque plateforme, des moteurs de recherche aux réseaux sociaux en passant par les assistants vocaux, devient une machine à produire ces réponses. Le format même de l’article s’efface progressivement au profit de formes conversationnelles, adaptatives, immédiates.
- Spotify est passé de la playlist à la daylist. Les deepfakes sont devenus un standard culturel. Et ce n’est pas le C2PA — pensé pour signaler les contenus générés par IA — qui permettra de sortir de cette opacité croissante. Tandis que l’industrie technologique le conçoit comme un outil de transparence technique, les médias, eux, y projettent un espoir presque symbolique : celui de redonner de la visibilité à l’humain (toujours selon Ezra Eeman).
- L’enjeu, pour les rédactions, est clair : ne pas se disperser dans des « fancy experiments » menées à partir de « messy data ». C’est là que les rédactions nativement construites autour de l’IA, comme le média indien Scroll, disposent d’un net avantage. Sa responsable du AI Lab for News, Sannuta Raghu, explique comment l’IA (toujours avec un humain dans la boucle) leur permet de produire jusqu’à 20 vidéos par jour dans un pays aux 22 langues officielles, où la recherche s’effectue majoritairement par commande vocale.
- Pour Joseph El Mahdi, News Commissioner à la Swedish Radio, le journalisme de qualité et les contenus générés par l’IA sont incompatibles. En revanche, la stratégie d’actualité de la SR intègre désormais l’assistance de l’IA : transcriptions, suggestions de titres, traitement de volumes massifs de données. Un outil comme « l’angle buddy » – Vinkelkompisen – vient soutenir ce processus éditorial, tandis que leur chatbot développé avec Neo de l’EBU est volontairement bridé pour éviter de répondre des fake news.
- Chez Semafor, Gina Chua voit une opportunité claire d’améliorer la relation avec les audiences grâce à l’IA : intégration d’articles connexes, de résumés, et de points de vue alternatifs pour anticiper les réactions du public et prendre en compte la diversité des perceptions. Khalil Cassimally de The Conversation considère ces outils comme un levier pour mieux comprendre les publics, en facilitant l’accès aux audience insights. Chacun peut désormais se construire son propre outil d’analyse de données, grâce au vibe coding.
- Au Wall Street Journal, l’IA générative est utilisée pour des chatbots spécialisés, comme Lars, assistant fiscal. Au New York Times, un bot a été conçu après deux mois de focus groups avec des équipes éditoriales. Deux tiers des besoins portaient sur des demandes de résumés, ce qui a conduit à la création d’Echo, capable de résumer n’importe quelle URL du NYT. Echo 2.0 ajoute une couche de jugement éditorial. Par ailleurs, au NYT, on préfère les « tiny experiments as a concept ».
- Dans la plupart des rédactions, l’IA (prédictive et/ou générative) est désormais soit intégrée directement dans le CMS, soit dans des « boîtes à outils » sur mesure (le NYT est en train de rassembler tous ses cas d’usage dans une même interface).

- Aujourd’hui, la technologie est la partie facile. C’est la validation éditoriale qui absorbe l’énergie. Il faut savoir définir ce qu’est un « bon contenu » pour l’expliquer à l’IA. The Guardian partage un échec plutôt qu’un succès : le résumé automatique dans ses live. « Fine-tuning takes a hell of human effort! » Il ne suffit pas d’apprendre à la machine ce qui est juste, encore faut-il lui enseigner ce qui est important. Or elle préfère ce qui est viral. Chris Moran en viendrait presque à expédier les deux podcasteurs de Notebook LM sur la lune, lassé par la course à la hype. Il reconnaît toutefois l’utilité de fonctions très ciblées, comme l’accès direct à un passage spécifique dans un PDF. Pour lui, l’IA intermédiarisera tout — appareils, plateformes — et ce sera « assez bon » pour le grand public. Son appel aux rédactions : « S’il vous plaît, ne recréez pas les mêmes outils. »
- Rappel : les LLM sont des Large Language Models, pas des Large Fact Models. La vérité est déterministe, non probabiliste.
« Fine-tuning [AI ]takes a hell of human effort! »
Chris Moran, The Guardian
- Sur les partenariats entre big tech et médias, Ezra Eeman note un net ralentissement. Karen Hao, ingénieure passée par le MIT et aujourd’hui journaliste à The Atlantic, rappelle que la tech de la Silicon Valley n’a jamais été alignée avec l’intérêt général. Selon elle, les rédactions s’associent à OpenAI en espérant des retombées positives — mais elle anticipe le même scénario qu’avec les réseaux sociaux : des relations asymétriques, puis une éviction brutale.

- Pour Ezra Eeman, « It’s better to be inside than outside ». Mais Karen Hao, forte de ses recherches pour son livre Empire of AI, insiste : le récit d’un progrès inéluctable vers l’IA générative et générale est une construction. Rien n’est inévitable. Et s’associer à des entreprises qui œuvrent, selon elle, à la mort du journalisme n’est peut-être pas la meilleure projection stratégique pour une rédaction. Sa formation pour The AI Spotlight Series, produite avec le Pulitzer Center, sera d’ailleurs accessible gratuitement plus tard dans l’année.
- Retour d’expérience : les modèles vieillissent vite. Ils doivent être retestés, réévalués régulièrement — un processus coûteux, chronophage, incompatible avec le rythme quotidien des rédactions. Le Wall Street Journal a d’ailleurs mis en place un poste d’éditeur de flux de travail dédié pour suivre ce cycle d’usure.
- Une question posée dans la salle : doit-on utiliser ces IA génératives ou non ? Réponse nuancée : Oui, si le cas d’usage n’exige pas de précision extrême et n’implique pas de contact direct avec le public. Non, si l’enjeu est critique et exposé.
- Avec, en arrière-plan, un mot d’ordre aussi séduisant qu’illusoire : Move fast without breaking things. Et si, justement, il était temps de briser deux ou trois certitudes ?
- Et pour l’instant, selon David Caswell, personne ne gagne de l’argent avec l’IA générative.
« Pour l’instant, personne ne gagne de l’argent avec l’IA générative. »
David Caswell
- Quelques faits cités par Karen Hao : en 2023, l’un des ensembles de données les plus utilisés pour entraîner les IA génératives d’images contenait du matériel pédopornographique. Le programme Apollo aurait coûté, en valeur actuelle, 300 milliards de dollars sur 15 ans pour aller sur la Lune ; 500 milliards seront investis en seulement quatre ans… pour développer de plus gros chatbots. À l’origine, la recherche en IA était universitaire, financée par les États, guidée par des impératifs d’efficacité. Aujourd’hui, elle est menée par des entreprises privées, autofinancées, disposant d’un accès illimité aux données et d’une puissance de calcul colossale — avec, pour principale boussole, l’envie de conquête de marché. Toujours plus vite, toujours plus grand.
- Espérons que le journalisme ne devienne pas le edge case scenario de l’IA générative et des Big Tech…
Comment devenir Full Stack Journalist ?
Dans la séance d’ouverture, Nic Newman résume 15 ans de « produit » en 7 minutes. Il y a 25 ans, la tech était encore marginale dans les rédactions. Dans l’histoire du « produit » — un terme qui reste flou pour beaucoup de journalistes (Nic Newman cite un sondage du Reuters Institute : 93 % des rédactions jugent le sujet important, mais seulement 45 % estiment en comprendre réellement les contours) —, le lancement de l’iPlayer fut un tournant. Mis en ligne le jour de Noël en 2007, après trois ans d’échecs, il marque l’introduction de la « méthode agile » dans l’univers des médias.
- Aujourd’hui, les données d’usage permettent de passer du minimum viable product à une minimum viable experience. On n’est plus face à un défi technologique, mais à un enjeu business.
- Dans la chaîne de décision, le pouvoir et les budgets restent souvent concentrés côté éditorial. Il serait peut-être temps d’expérimenter aussi une minimum viable structure. Point positif : le produit n’est plus une tendance, mais une position stratégique. Un levier de croissance. Et les meilleures idées ne viennent pas systématiquement du top management…

- Si l’on définit le produit comme un « échange de valeur avec l’audience », alors comment définir — et surtout évaluer — cette valeur ? C’est précisément ce qu’a tenté la table ronde « La valeur publique du journalisme : entre mesures individuelles et impact sociétal », réunissant Smartocto (qui détient toutes les métriques individuelles), Mattia Peretti (fondateur de News Alchemists) et Karlijn Goossen de 360 NPO. Tous trois interrogent le décalage entre ce que l’on mesure au quotidien et ce qui pousse un journaliste à se lever le matin — autrement dit, la valeur sociétale.
- Le User Needs Model (créé par Dmitry Shishkin) est-il plus pertinent dans sa version 2.0 avec Smartocto ? Ne regarde-t-on pas les mauvais chiffres, de la mauvaise manière ? La vraie question n’est-elle pas plutôt : que se passe-t-il dans le monde si demain nous ne sommes plus là ? On surindexe le comment, sans assez interroger le pourquoi.

- Il faudrait aller vers un rapport plus relationnel que transactionnel. Mais comment équilibrer la démonstration de valeur sociale avec celle de la valeur individuelle, dans une société centrée sur l’individu (question de l’audience) ?
- Pour Upasna Gautam, Senior Platform Product Manager chez CNN, « la confiance est un produit dérivé de la curiosité ». C’est elle qui introduit la notion de Full Stack Journalist, empruntée au vocabulaire produit : le contenu est le produit, et chaque journaliste doit savoir à la fois comment il est conçu, et comment il est distribué.
« La confiance est un produit dérivé de la curiosité »
Upasna Gautam, Senior Platform Product Manager chez CNN
- La position de gatekeeper est définitivement révolue. Pour rester pertinents, les médias doivent repenser leur fonction. Sans aller jusqu’au rôle de thérapeute — évoqué dans plusieurs panels —, il s’agit d’écouter plus finement les besoins des publics. Même si le résultat dérange, comme dans l’étude News for all que la BBC a longtemps hésité à publier, tant les résultats étaient jugés trop confrontants.
- The Globe and Mail, au Canada, a complètement revu l’organisation de sa rédaction après avoir constaté que trop de journalistes couvraient les mêmes types d’actualités. Une refonte structurelle pensée pour rééquilibrer les ressources éditoriales.

- Comme beaucoup d’intervenants, Ellen Heinrichs, fondatrice du Bonn Institute, appelle les rédactions à cesser de courir après le dernier gadget IA. Mieux vaudrait investir dans du journalisme résolument humain. Les publics ne réclament pas un chatbot sophistiqué qui s’exprime dans leur langage, mais des journalistes sur le terrain, dans leur quartier, capables d’écouter. Une forme de journalism as a service, qu’Ellen Heinrichs décline en trois mots-clés :
- Solutions — pas comme format, mais comme principe de leadership éditorial
- Perspectives — raconter une histoire à travers le regard d’un autre
- Dialogue — pour sortir de la logique binaire du pour/contre et introduire des nuances.
Créateurs en quête d’indépendance
L’économie des créateurs de contenu est estimée à 500 milliards de dollars d’ici 2027. Pendant ce temps, le modèle économique traditionnel des médias s’effondre. Le lien qui unissait autrefois les journalistes à une rédaction tout au long de leur carrière n’a plus cours. Dans cette brèche, certains journalistes franchissent le pas et deviennent eux-mêmes des créateurs de contenu. Mais cette reconversion n’est ni évidente ni forcément souhaitable, car elle implique une posture entrepreneuriale (se vendre, construire une audience, gérer une marque personnelle), souvent éloignée du rôle journalistique. Pour accompagner cette transition, des structures créées par d’anciens journalistes émergent afin d’aider leurs pairs à s’insérer dans cette nouvelle économie.
- Tous les médias s’interrogent sur la collaboration avec les créateurs de contenu. V Spehar, de Under the Desk News (3,5 millions d’abonnés sur TikTok), livre sa recette : miser sur des partenariats durables — comme ceux noués avec le LA Times ou le Washington Post — et non sur des opérations ponctuelles, alibi.
- Ce qui distingue les créateurs des rédactions : une maîtrise plus fine des sujets traités, et surtout une relation directe avec leur audience — par l’intermédiaire de plateformes et d’algorithmes dont ils restent dépendants. L’audience, ici, tient lieu de rédacteur en chef. « Je parle à mon public chaque jour. […] Nous produisons de l’information ensemble. Cela me coûte, mais cela me nourrit aussi. »
« Je parle à mon public chaque jour. […] Nous produisons de l’information ensemble. Cela me coûte, mais cela me nourrit aussi. »
V Spehar, Under The Desk News
- V Spehar est aussi lucide sur le contexte : ce lien se joue souvent dans l’intime — dans la salle de bains, pas dans le salon familial devant le téléviseur. Consciente de sa vulnérabilité face aux algorithmes, elle encourage les créateurs à rejoindre Substack, nouveau refuge perçu comme un espace plus sûr. Adeline Hulin, de l’UNESCO, complète : si le journalisme est une fonction, alors les créateurs de contenu (des « nano-newsrooms », selon la définition d’Ezra Eeman) relèvent, eux aussi, de la protection de cette fonction.

- L’économie des créateurs se structure : de plus en plus de marques investissent dans ce nouvel espace numérique, où les contenus indépendants attirent massivement les jeunes audiences. « On est clairement en train d’assister à une transition : les budgets publicitaires migrent des anciens formats vers ces nouveaux formats », constate Johnny Harris, ex-journaliste chez Vox devenu YouTubeur. Les marques suivent l’audience : selon une étude Deloitte, 56 % de la génération Z trouvent les contenus sur les réseaux sociaux plus pertinents que les films ou séries traditionnels, et près de la moitié se sentent plus connectés aux créateurs en ligne qu’aux présentateurs TV. Mais Tous les créateurs déconstruisent le mythe de la célébrité instantanée et sans effort. V Spehar a lancé sa carrière en parallèle d’un emploi à temps plein. Johnny Harris (6,5 millions d’abonnés sur YouTube) reconnaît volontiers que c’est sa femme qui gère le marketing.
- Pour Johnny Harris, les créateurs qui réussissent sont ceux qui maîtrisent un sujet spécifique. Un rappel utile pour les rédactions qui ont parfois trop vite abandonné l’expertise, pensant qu’il suffisait de bien présenter pour parler 1 min 20 à la télévision.
« On ne peut pas s’attendre à ce que tous les meilleurs journalistes aient aussi envie de devenir chefs d’entreprise »
Johnny Harris
- Être journaliste et entrepreneur, ce sont deux rôles bien différents, ce qui freine de nombreux journalistes à se lancer seuls. « On ne peut pas s’attendre à ce que tous les meilleurs journalistes aient aussi envie de devenir chefs d’entreprise », explique Harris, évoquant les risques financiers et l’endurance que demande le lancement d’une activité indépendante. Tous constatent un même mouvement : les plateformes sociales, saturées par l’économie de l’attention, ne suffisent plus. Les créateurs se tournent vers des modèles d’abonnement — entrant de fait en concurrence directe avec les médias traditionnels. Mais même sur Substack, selon Taylor Lorenz (ex-Washington Post, devenue indépendante), il faut publier au moins quatre à cinq fois par semaine pour espérer émerger.
@underthedesknews How do you say Banana in Italian? #news #italy ♬ original sound – UnderTheDeskNews
- Pour répondre à ces obstacles, Johnny Harris a conçu une structure de transition reposant sur les abonnements et la publicité, servant de rampe d’accès vers l’économie des créateurs, tout en protégeant les journalistes des aspects les plus complexes de l’entrepreneuriat.
« Ils ne veulent pas forcément diriger une organisation, embaucher du personnel, gérer des impôts ou négocier des partenariats de marque. Ce qu’ils veulent, c’est faire du journalisme », poursuit-il. - Réinventer le modèle de distribution des reportages de terrain : En parallèle, Jane Ferguson a fondé Noosphere, une plateforme vidéo pensée pour les journalistes indépendants, souvent en zones de conflit, afin de publier leurs reportages en toute liberté et être rémunérés directement par leur public. Inspirée de Substack ou YouTube, Noosphere repose sur un modèle d’abonnement : les journalistes reçoivent 50 % des revenus des abonnements qu’ils génèrent, tout en conservant une liberté éditoriale totale. La plateforme offre aussi un soutien logistique (formation à la sécurité, assurance, équipements), tout en permettant aux journalistes de collaborer avec d’autres médias s’ils le souhaitent.

- L’enjeu : sortir de la dépendance aux plateformes classiques et redonner du pouvoir aux journalistes. « Personne ne peut vous virer, soutient Ferguson. La désintermédiation est le futur. » Ce modèle répond aussi à une pression constante ressentie par les créateurs. Pas besoin de constamment poster pour tout simplement exister. Selon Patreon, 75 % des créateurs estiment être pénalisés s’ils ne postent pas régulièrement, ce qui alimente la fatigue dans l’économie de l’attention.
- Patreon s’impose comme un pilier pour l’indépendance éditoriale : lors d’une table ronde parallèle, plusieurs journalistes indépendants ont expliqué comment ils s’éloignent des structures traditionnelles pour produire des contenus en dehors des logiques industrielles. Patreon devient une solution concrète pour sécuriser des revenus récurrents, permettre une plus grande liberté de ton et travailler pour une communauté engagée, plutôt que pour les algorithmes.
- Adam Cole (HowTown) illustre le parcours exigeant vers l’autonomie : ancien de NPR, il raconte le contraste entre les espoirs initiaux et la réalité du lancement. Aujourd’hui, sa chaîne YouTube rassemble plus de 719 000 abonnés. Son modèle repose sur trois sources de revenus équilibrées : un tiers Patreon, un tiers monétisation YouTube, un tiers sponsoring via des intégrations. Une répartition qui lui permet de créer du contenu avec sens, même pour une audience plus restreinte.
- Une stratégie partagée par d’autres créateurs présents : Samuel Muna, fondateur d’un média africain indépendant, et Gloria Chan, cofondatrice de Green Bean Media, utilisent eux aussi Patreon pour construire un modèle d’abonnement mensuel stable. L’objectif : produire autrement, sans dépendre d’un volume massif d’audience, en misant sur un lien direct avec leurs soutiens.
- Johnny Harris résume ce qui fait le succès de ses documentaires de 40 minutes : « Une grande partie de ma narration consiste à faire cheminer le public à travers le processus de construction de l’information. » L’objectivité n’est plus la norme ; la confiance passe désormais par l’authenticité. Les jeunes audiences n’ont d’ailleurs plus la même définition de l’information qu’une rédaction classique — tout en rappelant qu’« authenticité n’est pas vérité ». Interrogé sur la taille de son équipe : 17 personnes. « Je suis accidentellement devenu une entreprise média. »
« Je suis accidentellement devenu une entreprise média. »
Johnny Harris
- De son côté, Sophia Smith Galer cherche à diversifier ses revenus. Elle a fait tester, en terrasse, une application à destination des créateurs qui transforme n’importe quel texte en prompt (la aignification télé ancienne) pour enregistrer une vidéo. Une interface minimaliste pensée pour simplifier le passage à l’écran. Sur les réseaux sociaux, selon elle, l’enjeu n’est plus de « toucher les jeunes », mais d’atteindre une large audience d’utilisateurs numériques. Sa méthode : une formule en 3 I. Instinct : une histoire vous interpelle. Insights : vous vérifiez tous les éléments, en lien avec ce que vous avez déjà produit. Impact : en quoi ce contenu se distingue-t-il de celui de vos concurrents — car l’espace est saturé. Autrefois pionnière, elle se retrouve aujourd’hui en concurrence directe avec l’ensemble des créateurs d’actualité. Et rappelle qu’une vidéo de 90 secondes doit être aussi sourcée et rigoureuse qu’un article…

La Muskification des médias
« Les big tech représentent une menace existentielle pour le journalisme », déclare Clayton Weimers, directeur exécutif de Reporters Sans Frontières USA, lors d’une table ronde intitulée The Muskification of American Media. « Quelles solutions face à la désinformation lorsque des hommes puissants en sont à l’origine ? », interroge-t-il. Pour Courtney Radsch, directrice du Center for Journalism and Liberty, la réponse est claire : « Les médias doivent couvrir les géants de la technologie de manière beaucoup plus critique. » Aux côtés de Patricia Campos Mello, éditrice en chef de Folha de São Paulo, et d’Anya Schiffrin, professeure à la School of International and Public Affairs de l’Université de Columbia, le panel a exploré ces questions et proposé plusieurs solutions.
- La bataille autour des mots sert les intérêts des grandes plateformes. La « muskification » relève d’un double langage orwellien, estime Courtney Radsch : « Les choses sont mélangées, on appelle la censure discours libre. » Elle dénonce l’usage stratégique de termes comme « censure » ou « antiaméricanisme » pour discréditer les régulations, telles que le DSA ou l’AI Act. Le panel évoque la polémique autour de l’expression « Golf of America », qui oppose Donald Trump à l’Associated Press, comme exemple de cette confusion entretenue dans l’espace public. Même logique au Brésil, où Patricia Campos Mello rappelle comment Elon Musk s’est abrité derrière la liberté d’expression pour contester une décision de justice. Face à ces tentatives de manipulation, les intervenants insistent : les définitions doivent être claires. Médias, gouvernements et citoyens ne peuvent se permettre de laisser les “tech bros” redonner une définition aux mots.
- Pas besoin de nouvelles lois, affirment les intervenants. Les outils existent déjà, encore faut-il les utiliser. « L’Union européenne devrait tenir bon et s’inspirer du Brésil », estime Courtney Radsch. Lois contraignantes, politiques de concurrence, règles antitrust, fiscalité, exigences en matière de transparence et de droits d’auteur : la boîte à outils est là. Reste à l’ouvrir. Pour les panélistes, face à la puissance des big techs, il est temps de faire appliquer les règles, pas de les réécrire.
- Les rédactions doivent changer de regard sur la tech, plaide Clayton Weimers. « Il faut cesser de traiter la tech comme une simple rubrique. C’est un mouvement politique à part entière. » Derrière les promesses d’innovation, des idéologies s’imposent. Anya Schiffrin, parmi d’autres, parle de « techno-fascisme », tandis que Courtney Radsch alerte sur les biais inscrits dans les grands modèles de langage. « L’IA d’Elon Musk entre à la Maison-Blanche », ironise-t-elle. Dans le même temps, certaines rédactions signent des accords avec les plateformes pour « quelques dollars » et relaient l’idée que cette évolution serait inévitable. Une illusion, selon elle.

- Lutter contre les” techno fascistes” c’est aussi s’abonner aux médias. Anya Schiffrin confie être entourée de personnes qui cherchent comment agir, sans risquer l’expulsion du territoire américain. Sa réponse est simple : s’abonner à la presse indépendante, soutenir des titres comme le New York Times ou d’autres médias de référence. Un geste concret pour renforcer un écosystème journalistique sous pression et résister aux tentatives de musellement.
- À la question « La pression publique peut-elle créer du changement ? », la réponse est unanime et radicale : « Non, la pression publique ne peut être exercée tant que les grandes plateformes contrôlent les algorithmes. »
- David Caswell fait dans une autre table ronde un excellent résumé du parcours média du patron Tesla par ses traces laissés sur le numérique, dont ce tweet qui explique sa vision de la modération :

- Plus tard c’est « Notre objectif est de maximiser le nombre de secondes d’utilisation sans regret. Trop de contenus négatifs sont poussés, ce qui augmente certes le temps passé techniquement, mais pas le temps que les utilisateurs ne regrettent pas. ». Et d’ici 2029, selon les amis de Musk, l’IA sera plus intelligente que les humains.
- Toute cette belle idée d’un Internet décentralisé s’avère, en réalité, terriblement centralisée. Ce qui ressort de cette table ronde : renforcer les compétences techniques, développer un contre-pouvoir épistémique fondé sur la compréhension, et établir un standard d’excellence pour l’information. La solution passerait-elle par Community Notes ? Nous glissons d’un modèle où la confiance reposait sur un journaliste identifiable à un modèle où elle est transférée à la foule. Comme le souligne Yuval Harari, ce n’est pas l’abondance d’informations qui renforce une société — nous en avons fait l’expérience —, mais sa capacité à rechercher la vérité et à se corriger elle-même.
New: @elonmusk emailed me about his plan for AI news on X.
— Alex Kantrowitz (@Kantrowitz) May 3, 2024
The idea is to use AI to blend breaking news and commentary, building real-time summaries of events. Then you can go deeper via chat on Grok.
Here's the full story! I'll be talking more about this on Big Technology…
Comment les empereurs de l’IA de la Silicon Valley reconfigurent la réalité
Christopher Wylie, lanceur d’alerte dans l’affaire Cambridge Analytica, tire la sonnette d’alarme : la Silicon Valley n’est plus un simple centre d’innovation technologique, mais un mouvement idéologique dangereux, une « secte religieuse ». « Ce sont les hommes les plus riches du monde, à la tête des entreprises les plus puissantes au monde », déclare-t-il. Il n’est pas le seul à voir émerger une idéologie anti-humaine, façonnée par des « tech bros » qu’il qualifie de «cinglés », convaincus que les machines doivent supplanter l’humanité et dénonce un « anti-humanisme » rampant, masqué sous le vernis du progrès.

- Selon Christopher Wylie, lanceur d’alerte dans l’affaire Cambridge Analytica, la Silicon Valley ne se limite plus à une simple révolution technologique ; elle s’est transformée en un mouvement religieux, une “secte” porté par des milliardaires et des « tech bros », des “nutters” (des cinglés) qui prêchent avec conviction une vision du futur où l’humanité serait supplantée par des machines. La différence avec les autres sectes ? Une puissance inégalée. “Ce sont les hommes les plus riches du monde, à la tête des entreprises les plus puissantes au monde”, résume-t-il. “Quand vous avez un groupe d’hommes qui pensent qu’ils vont remplacer l’humanité par des machines, c’est une idéologie anti-humaine. Et je pense que ce qui continue de grandir à la Silicon Valley, c’est l’anti-humanisme. Ils appellent ça le transhumanisme mais en réalité c’est une volonté de remplacement des humains”, observe Christopher Wylie.
- Mais ce fanatisme technologique n’est pas suffisamment scruté, selon Julie Posetti (International Center for Journalists) : « Nous avons peur de traiter les fous sérieusement (…). Ces missions sont réelles et totalement financées.» Elle alerte sur les parallèles avec la couverture médiatique trop laxiste de Donald Trump. Même constat chez le lanceur d’alerte : la presse reste trop passive, concentrée sur les derniers outils et ne prend pas au sérieux les “prophéties” de ces hommes surpuissants et connectées à la Maison Blanche.
- Christopher Wylie va plus loin et qualifie la Silicon Valley de mouvement fasciste. Il cite le manifeste techno-optimiste de Marc Andreessen, qui célèbre Filippo Tommaso Marinetti – cofondateur du fascisme italien – comme un « saint ». « Les fascistes ont toujours été obsédés par le futur. A quoi pensaient les fascistes il y a 100 ans ? A des hommes forts qui bouleversaient la société pour imposer leur vision du futur, et tous les faibles devaient s’écraser sous eux, pour un avenir glorieux. Aujourd’hui, c’est la même merde, tranche Wylie. Avant de parler régulation, il faut qu’on parle de comment résister au fascisme ? Comment est-ce qu’on aurait régulé Mussolini, franchement ? ».
« D’un côté, des journalistes pensent à sauver la technologie ; de l’autre, des tech bros pensent à comment vivre après la démocratie ».
Christopher Wylie
- Pour lui, un fossé béant s’est creusé entre les journalistes et les milliardaires de la tech : « D’un côté, des journalistes pensent à sauver la technologie ; de l’autre, des tech bros pensent à comment vivre après la démocratie ».

- Pour Martin Andree, auteur de Big Tech Must Go!, le diagnostic est clair : les Big Tech ont mis la main sur l’intégralité de l’écosystème de l’information. Tout le trafic internet se déroule désormais à l’intérieur des plateformes — résultat d’une combinaison redoutablement efficace : effets de réseau, systèmes fermés, suppression des liens sortants (un peu comme un grand magasin sans issue), contenus générés gratuitement par les utilisateurs, et auto-référencement algorithmique. Même le récit de l’évolution technologique est contrôlé… par ceux qui en tirent profit.
- Peu importe que le journalisme soit financé par des fonds publics ou privés : ce que nous sommes en train de perdre, ce n’est pas le contenu, mais sa visibilité. L’imprimerie avait transformé la distribution. L’IA, elle, bouleverse à la fois la production et la distribution. Mais Andree avance aussi des pistes concrètes : ouvrir les plateformes aux liens sortants ; imposer des standards ouverts ; séparer économiquement distribution et production de contenus ; fixer une part de marché maximale de 30 %, y compris pour les médias numériques ; interdire la monétisation de contenus criminels (ce qui paraît naturel).

- En attendant, les médias se retrouvent face à une alternative piégée, résumée dans un diagramme simple : publier sur les réseaux sociaux et travailler gratuitement pour les Big Tech, ou publier sur leurs propres sites et disparaître dans le silence algorithmique. Il pose alors la question essentielle : quelles implications pour notre réalité partagée ? Sommes-nous en train d’entrer dans une illusion — celle d’un espace médiatique ouvert, participatif — alors que, dans les faits, l’effet de réseau enferme, et que la machinerie est aux mains de quelques-uns ? Un monopole médiatique ne devrait-il pas être considéré comme anticonstitutionnel ? Selon lui, il ne s’agit pas de réguler, mais de libérer. « Ils ont volé Internet. »
« Ils ont volé Internet. »
Martin Andree
- Le débat ne doit pas être anti-technologique, mais doit cibler les usages, les abus, et la captation du mot “tech” par quelques puissants. « La Silicon Valley s’est auto-proclamée, de manière vraiment narcissique, comme étant la technologie — ce qui est absurde.» Christopher Wylie rappelle que la majorité des ingénieurs sont sincèrement engagés pour le bien commun : « Nous sommes contre les abus, contre la financiarisation de toute la société, contre l’exploitation émotionnelle, et contre la destruction des sociétés civiles.»
Quatre ans pour ne pas disparaître
Avec l’IA, nous sommes à l’aube d’une saturation totale : une avalanche de contenus générés à grande vitesse, souvent creux, parfois toxiques — dans un monde où la capacité à comprendre devient plus vitale que jamais. Ezra Eeman, dans sa présentation Wayfinder, toujours aussi claire et synthétique malgré le chaos ambiant, décrit bien le glissement de pouvoir : d’un côté, des groupes médiatiques capables de produire à grande échelle ; de l’autre, des individus qui créent de la valeur. Mais tous dépendent de plateformes qu’ils ne contrôlent pas.
Demain, travaillerons-nous dans des rédactions cybernétiques ? Le risque n’est pas seulement celui de machines qui singent mal l’humain, mais aussi d’humains qui finissent par imiter la machine — mal.
Un mouvement anticyclique se dessine : d’un côté, une prise de conscience des rédactions face à des Big Tech qui maîtrisent toute la chaîne de valeur, de la création à la diffusion ; de l’autre, une course effrénée à l’intégration de l’IA, pour rester dans la course… que dictent justement ces mêmes acteurs. Au final, le journalisme assisté par IA pourrait bien être l’un des derniers espaces où les humains restent dans la boucle. Ailleurs, ils seront progressivement exclus du circuit.
Que pouvons-nous créer qui nous soit véritablement propre ?
Qu’est-ce qui donnerait à quelqu’un une bonne raison de venir chez nous plutôt qu’ailleurs ?
Martin Andree estime qu’il reste quatre ans avant que les Big Tech ne prennent le contrôle total du système médiatique. Lorsque des figures de la Silicon Valley commencent à se présenter comme les prophètes d’une religion dont l’IA serait le Dieu — omnisciente, omnipotente, omniprésente — il est peut-être temps de reconnaître que le problème dépasse la seule question technologique. Conclusion d’un International Journalism Festival… sponsorisé par Google.

Images : KB, sauf contre-indication